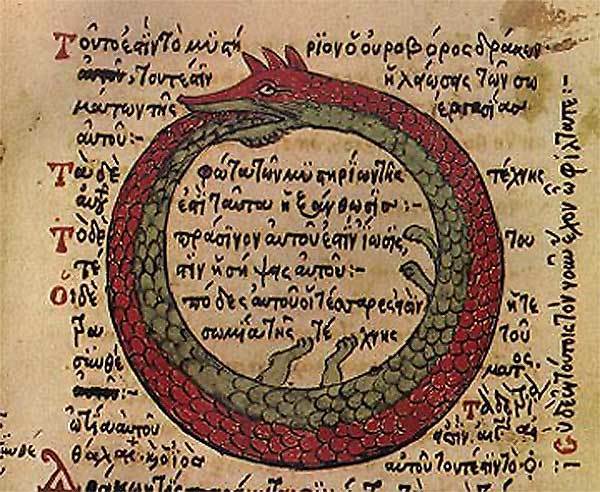Chronique uchronique : 1588, l’Armada Invaincue – Nonfiction
Le matin du 1er août 1588, au large de Plymouth, Sir Francis Drake est inquiet : le vent faiblit. Voici plusieurs jours maintenant que sa partie de la flotte anglaise poursuit à distance la monstrueuse Armada espagnole, forte de 130 vaisseaux et 30 000 hommes, venue envahir l’Angleterre sur ordre du roi d’Espagne Philippe II.
Le projet flottait dans l’air depuis plusieurs années, au moins depuis l’excommunication de la reine Elizabeth par la papauté en 1570 – au point que les chancelleries européennes lui avaient donné un nom de code : « l’Entreprise ». Mais c’est à partir de 1585 que l’attaque prend forme, en représailles du soutien élisabethain aux révoltés des Pays-Bas, et aux attaques des corsaires britanniques sur les possessions espagnoles. La flotte espagnole prend donc la mer, après une longue préparation, au printemps 1588.