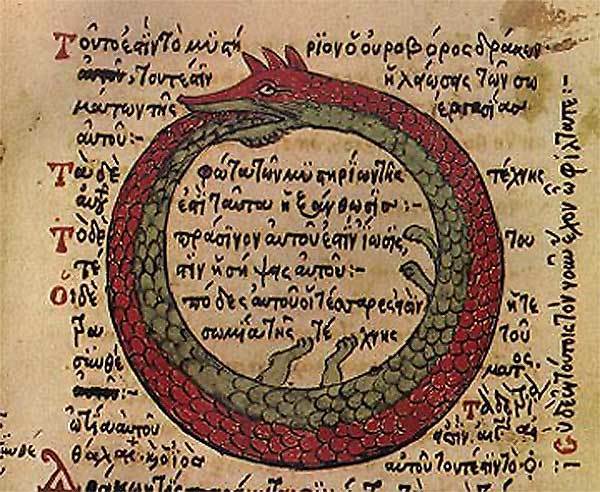Chronique uchronique n° 0 : Jouons avec des « si » – Nonfiction
L’uchronie est une forme d’écriture qui consiste à réécrire l’histoire à partir d’un moment-clé, un pivot (un turning point), qu’on fait jouer différemment. Que se serait-il passé si… ? Si De Gaulle était mort en 1939 ? Si César avait perdu à Alésia ? Si les Aztèques avaient eu des chevaux ? Histoire au conditionnel, l’uchronie est très à la mode dans la science-fiction, en particulier anglaise et américaine. Des auteurs aussi prestigieux que Philippe K. Dick, Kim Stanley Robinson, Robert Silverberg, Stephen Fry, s’y sont essayé . On la retrouve comme ressort narratif dans des films, de La Vie est belle de Capra (1946) à Inglorious Basterds de Tarantino (2009). Elle est au cœur de mangas, comme Zipang , de comics , de bandes dessinées – citons en particulier la série Jour J . Mais il s’agit aussi d’une démarche historique à proprement parler, signalée déjà par Max Weber, puis par Paul Ricoeur et Antoine Prost, et bien étudiée, en France, par Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou . Dans son essai récent, L’Histoire est une littérature contemporaine, Ivan Jablonka en signalait toutes les potentialités. De nombreux historiens se sont livrés à l’exercice : citons Robert Fogel, Niall Ferguson, Robert Cowley, et, en France, Jacques Sapir, Anthony Rowley et Fabrice d’Almeida . En jouant sur les pivots, l’uchronie invite à réfléchir en profondeur sur les causes d’un événement. Or la réflexion sur les causes et les conséquences des événements est le cœur du travail de l’historien, l’histoire étant la science du changement social. Florian BESSON